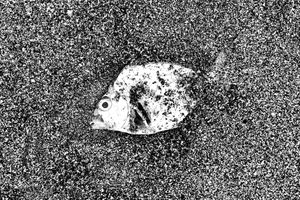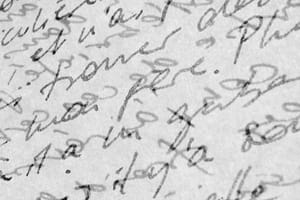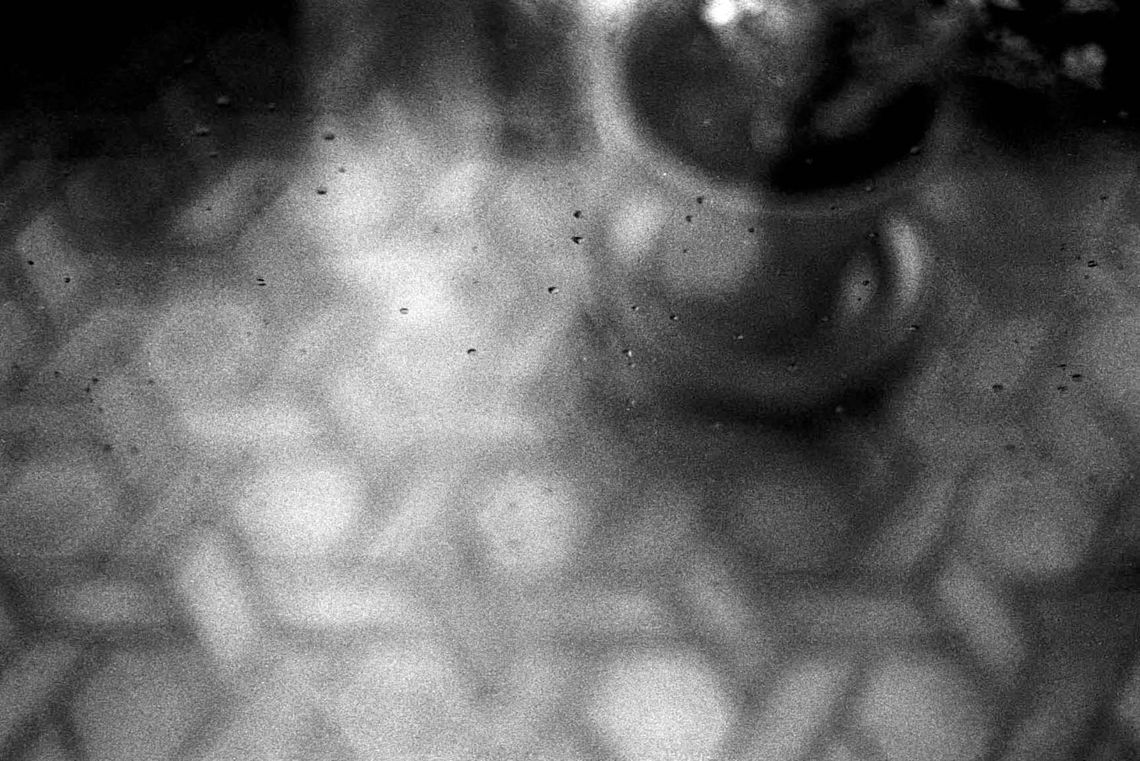
Le balcon de Frédérique
On dit que mes parents auraient offert à Frédérique le rosier qui arbore le côté droit du balcon. Un balcon? Que dis-je, c’était un jardin luxuriant de trois mètres carrés qui avait, au fil des décennies, largement débordé sur la moquette beige de l’appartement. Il y vivait des espèces de plantes disparates qui n’avaient en commun qu’un arrosoir fatigué et la vue consolante sur les toits de Neuilly.
Ce carré de verdure précédait au spectacle de la frondaison d’arbres du boulevard Victor Hugo. Il était comme le gardien de la balustrade et une des seules raisons d’être du store jaune-poste qui calmait le soleil parfois sévère. Frédérique ouvrait souvent la large baie vitrée comme pour laisser entrer dans son salon les multiples nuances de vert qui venaient converser avec le rouge épiscopal du canapé et les livres empoussiérés qui soutenaient le bois vermoulu de la bibliothèque.
C’est du moins ce que je pensais naïvement avant de comprendre, à mes dépens, que Frédérique ouvrait souvent la fenêtre pour laisser respirer le nuage gris-bleu soulevé par ses Gitanes sans filtre qu’elle écrasait à longueur de journée dans le cendrier en porcelaine qui trônait au centre de la table.
Parfois j’enviais les plantes qui vivaient à l’extérieur dans les miasmes de la ville. Je les enviais surtout les jours de pluie ou ceux de grand froid lorsqu’on ne pouvait pas ouvrir. Le son de la molette du briquet était devenu pour moi un métronome qui toquait les longues minutes qu’il me restait avant de quitter cette femme — une de mes figures maternelles — chez qui je voyais se dissiper à chacune de mes visites le plaisir de m’y réfugier à nouveau.
Ce jour-là, il pleuvait. Il avait plu pendant quatre jours. Ce jour-là, je n’avais que mes yeux pour respirer.