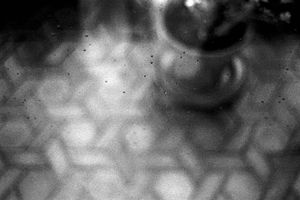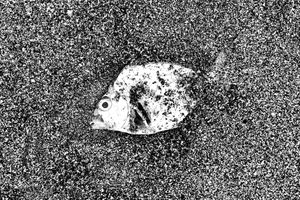Chambre 108
Je devrais savoir mieux que quiconque qu’une photographie porte toujours un mensonge — surtout celles de chambres d’hôtel sur les sites de réservation. Il y a donc une autre raison qui m’a poussée à poser mon sac dans cette chambre avec vue sur un rideau (qui lui, ô chance, a une vue sur la réception).
L’océan est là, j’entends son appel sourd; je ne voulais pas repartir d’ici sans lui livrer ce que j’ai sur le cœur. Il est à deux pas de mon hôtel, de l’autre côté du beach club qui, comme tant sur ces côtes, a réussi son hold-up cupide sur le littoral et sa prise en otage de la vue.
Les premières lueurs de l’heure bleue débordent du rideau de ma chambre. Je prends congé de mon dernier rêve, me lève, enfile un short, un t-shirt, prends mon boîtier en bandoulière, mon mobile, la clé de la chambre dans la poche arrière et je pars pieds nus dans la direction des embruns. Le veilleur de nuit dort encore sur le sol de l’entrée et au loin j’entends le bal déjà vibrant des motos et des vans de surfeurs qui convergent pour découvrir le swell du jour. Ce sont les derniers moments de la marée basse et le début imminent de la montante devrait commencer à creuser les vagues. Au large, il y a déjà foule sur le line-up. Je vois des dizaines de têtes qui dodelinent au rythme lent de la houle et chacun semble attendre patiemment l’avènement de sa vague.
À l’entrée de la plage, sept marches descendent entre deux inquiétantes sorties de canalisations. Chaque surfeur y marque un temps d’arrêt pour jauger des conditions avant de descendre, planche sous le bras, pour s’adonner à son rituel matinal.
Le mien sera fait de contemplation. À eux les vagues, à moi la longue plage presque déserte. C’est l’heure des rencontres improbables. Les chiens errants sont encore enroulés dans leurs niches de sable et lèvent nonchalamment le museau au passage des lève-tôt. Les fêtards cuvent leur nuit blanche le regard hagard et le revers du pantalon ensablé. Les joggers, la tête entre leurs écouteurs, fixent avec détermination la perspective de la plage et semblent vouloir nous montrer qu’ils bossent dur pour vivre leur meilleure vie. Les habitants du coin, venus profiter de la fraîcheur, offrent leur sourire en préambule aux premiers rayons qui se laissent désirer. Les bateaux de pêcheurs sont déjà rentrés. Les paillottes sont encore fermées, sauf une qui dispense des cours de surf à quelques touristes reconnaissables à leurs airs peu rassurés et leurs visages maladroitement tartinés d’une épaisse couche de protection solaire.

Une femme dans sa solitude s’offre en miroir à la mienne. Elle se promène sans autre but apparent que de tout immortaliser avec son téléphone. Mon regard a été attiré parce qu’elle était en tenue de yoga et qu’elle a gardé ses tongs comme pour ne pas se salir les pieds avec le sable noir — comme si le sable était sale parce qu’il était noir. Elle s’arrête cinquante mètres devant moi et me tourne le dos pour observer les surfeurs au loin. La scène est graphique: l’horizon, l’écume des nuages en reflet de celle des vagues, une dizaine de têtes au loin et une femme dans ses pensées qui les regarde. J’en garde un souvenir avec mon téléphone et lorsque je retrouve par hasard la femme quelques minutes plus tard en haut des marches, je lui montre le cliché et offre spontanément de le lui envoyer.
Je ne pensais pas que je verrais un jour le regard de quelqu’un autant briller en se regardant, et ce, après qu’elle se soit adonnée à près d’une heure d’onanisme photographique avec son mobile. Sans même me dire bonjour, elle me lance: «AirDrop?». Je m’exécute sans sourciller, mais le courant ne passe pas entre son téléphone coréen et le mien. D’un ton autoritaire, elle m’ordonne alors: «Instagram?». Je m’exécute encore une fois, entends aussitôt la notification de livraison et alors qu’elle est à un mètre de moi, je ne reçois en réponse à mon envoi aucune parole, mais sur mon écran un généreux «Thx» accompagné d’un emoticon «soleil avec un visage» et désormais la vue de son compte qui étale une diarrhée égotique qui renforce mon inquiétude déjà bien ancrée au sujet de la santé mentale de notre monde connecté.
Après cette tentative de rapprochement infructueuse entre la Corée (du nord, sans doute) et la Suisse (toujours internationale), je regagne la cellule cent-huit dans la ruelle derrière le beach club, les pieds sales, les lèvres salées et le cœur plus lourd qu’en partant. Sous la lumière blafarde du plafonnier, je m’assieds au bord du lit et écoute le rideau qui semble vouloir me livrer ses métaphores et la rassurance que derrière les obstacles, je serai un jour vu.